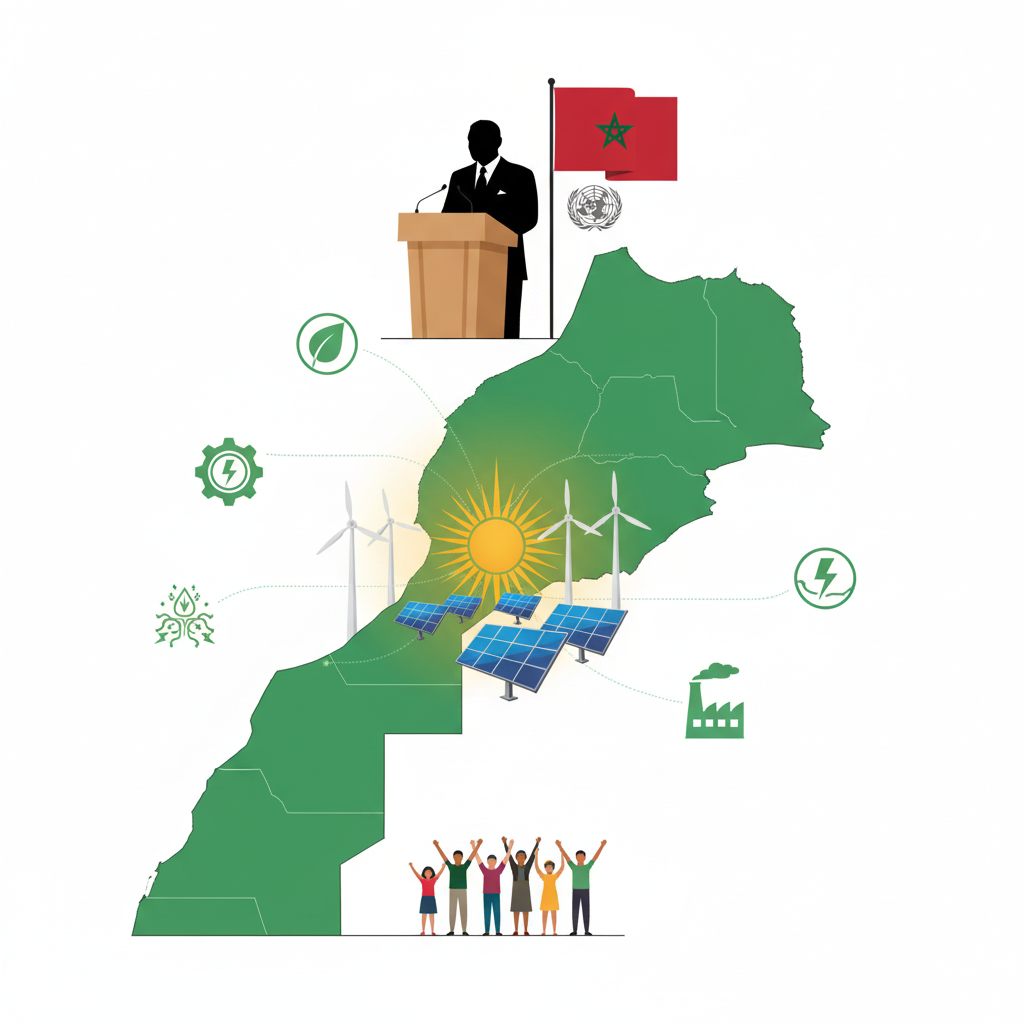Quand géopolitique et transition énergétique se rejoignent
Le 31 octobre 2025 restera gravé dans l’histoire diplomatique du Maroc. Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, par 11 voix sur 15, une résolution historique reconnaissant le plan d’autonomie marocain pour le Sahara comme « la solution la plus crédible et la plus réalisable » au conflit régional. Cette victoire diplomatique majeure, obtenue avec le soutien actif des États-Unis et de la France, arrive à un moment charnière où le royaume réaffirme sa souveraineté nationale tout en consolidant son leadership climatique africain.
Quelques jours plus tard, le 6 novembre 2025, Sa Majesté le Roi Mohammed VI devrait adresser un discours solennel à la Nation à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la Marche Verte, événement fondateur de l’unité nationale marocaine. Ce discours royal devrait tracer une vision prospective articulant trois piliers indissociables : souveraineté territoriale, développement durable et transition énergétique, avec un focus particulier sur les provinces du Sud où se dessine l’avenir énergétique du pays.
Comment ces évolutions diplomatiques s’articulent-elles avec la stratégie marocaine en matière d’énergies renouvelables ? En quoi Dakhla et Laâyoune deviennent-elles les symboles d’un nouveau modèle alliant stabilité politique et économie climatique ? Explorons cette dynamique qui positionne le Maroc comme pionnier africain d’un développement où géopolitique et écologie convergent.
Une victoire diplomatique qui change la donne
L’adoption de la résolution onusienne du 31 octobre 2025 marque un tournant décisif dans un conflit qui empoisonne la géopolitique du Maghreb depuis un demi-siècle. Pour la première fois, le Conseil de sécurité reconnaît explicitement le plan d’autonomie présenté par Rabat en 2007 comme référence centrale pour la résolution du différend, rompant ainsi avec la neutralité traditionnelle de l’instance internationale.
Cette avancée diplomatique reflète l’élargissement continu du cercle des pays soutenant la position marocaine. Après les États-Unis sous l’administration Trump en 2020, puis la France en 2024, de nombreux États d’Amérique latine, d’Afrique et récemment la Belgique ont reconnu la marocanité du Sahara ou soutenu le plan d’autonomie. Cette dynamique diplomatique s’appuie sur un investissement massif du Maroc dans le développement des provinces du Sud, transformant progressivement la perception internationale du dossier.
La résolution invite désormais le secrétaire général de l’ONU et son émissaire à poursuivre les discussions « sur la base » du plan marocain, consacrant ainsi l’autonomie sous souveraineté marocaine comme norme de facto sur la scène internationale. Ce basculement géopolitique ouvre la voie à une stabilisation durable du Maghreb et renforce la capacité du Maroc à attirer des investissements structurants dans ses provinces méridionales.
Vision royale : souveraineté, développement et énergies propres
Le discours attendu de Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 6 novembre 2025 devrait articuler plusieurs dimensions complémentaires. La confirmation du caractère définitivement marocain du Sahara sera accompagnée d’un bilan des réalisations accomplies au cours des cinq dernières décennies dans les provinces du Sud.
Les grands projets structurants seront mis en avant : le port atlantique de Dakhla, infrastructure maritime de classe mondiale capable d’accueillir les plus grands navires commerciaux ; la route express Tiznit-Dakhla qui désenclave les provinces méridionales ; et surtout, les programmes massifs d’énergies renouvelables à Laâyoune et Boujdour qui transforment ces territoires en pôles énergétiques continentaux.
La vision royale inscrit ces développements dans une perspective atlantique et africaine ambitieuse. Le Sahara marocain n’est plus perçu comme une périphérie mais comme un hub stratégique reliant l’Europe à l’Afrique subsaharienne, à travers l’économie bleue, le développement logistique et l’intégration énergétique régionale. Cette approche holistique conjugue stabilité politique, prospérité économique et transition écologique, créant ainsi un modèle de développement territorial durable.
Le souverain devrait également réaffirmer que l’Initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine demeure la seule base réaliste pour une solution définitive au différend régional, tout en appelant à un engagement citoyen renforcé dans la dynamique de développement des provinces du Sud.
Stratégie énergétique nationale : le Sud au cœur de la transition
La dimension énergétique constitue le pilier le plus spectaculaire de cette transformation territoriale. Avec six projets d’hydrogène vert programmés dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra, Guelmim-Oued Noun et Dakhla-Oued Eddahab, le Maroc franchit une étape décisive dans sa stratégie de décarbonation. Ces investissements représentent un montant global de 370 milliards de dirhams, soit l’équivalent de 37 milliards de dollars, structurant un pôle industriel et énergétique inédit à l’échelle continentale.
Ces chantiers s’inscrivent dans la continuité de la Stratégie Énergétique Nationale lancée en 2009, qui vise à porter à 52% la part des énergies renouvelables dans le mix électrique national d’ici 2030. À fin mai 2025, cette part atteignait déjà 45%, avec 5 499 MW installés répartis entre éolien, hydroélectrique, solaire et stations de pompage. Cette montée en puissance témoigne d’une volonté politique constante et d’une capacité d’exécution remarquable.
Le port atlantique de Dakhla, dont les travaux avancent rapidement, accueillera le projet Dahamco, coentreprise maroco-émiratie représentant un investissement colossal de 25 milliards de dollars pour la production d’hydrogène vert et d’ammoniac. La première phase permettra la production d’un million de tonnes d’hydrogène vert par an, positionnant le Maroc comme acteur incontournable de la transition énergétique mondiale.
Les provinces du Sud bénéficient d’atouts naturels exceptionnels : un ensoleillement annuel dépassant 3000 heures, des vents atlantiques puissants et réguliers, et des espaces disponibles pour déployer des infrastructures à grande échelle. Ces conditions idéales expliquent la concentration des projets d’hydrogène vert dans cette région stratégique, transformant progressivement Dakhla et Laâyoune en capitales africaines de l’énergie propre.
Économie climatique : investissements, partenariats et emplois verts
La dynamique énergétique engagée dans les provinces du Sud génère un écosystème économique complet, dépassant largement la seule production d’électricité. Les six projets d’hydrogène vert mobilisent des investisseurs nationaux et internationaux, créant un modèle de financement mixte qui sécurise les ressources nécessaires tout en diversifiant les partenariats stratégiques.
La signature du premier contrat de réservation de foncier dans le cadre de « l’Offre Maroc » en 2025 marque le début opérationnel de cette transformation, avec une accélération programmée tout au long de 2026. Les projets combinent production d’énergies renouvelables (solaire et éolien), électrolyse pour la production d’hydrogène, synthèse d’ammoniac et infrastructures portuaires et de transport pour l’exportation vers les marchés européens et asiatiques.
Cette chaîne de valeur intégrée génère des milliers d’emplois qualifiés dans les provinces du Sud : ingénieurs, techniciens de maintenance, logisticiens, gestionnaires de projets et personnel portuaire. Les programmes de formation professionnelle accompagnent cette montée en compétences, permettant à la jeunesse locale de s’insérer durablement dans l’économie verte.
Au-delà des emplois directs, l’effet d’entraînement sur les secteurs connexes est considérable : construction, services, commerce, tourisme d’affaires, et développement urbain bénéficient de cette dynamique. Les recettes fiscales générées permettent aux collectivités locales de financer des infrastructures sociales (écoles, hôpitaux, équipements sportifs) et d’améliorer la qualité de vie des populations.
Le Maroc développe également un écosystème industriel lié à l’hydrogène : fabrication de composants pour électrolyseurs, ingénierie de systèmes de stockage, et recherche-développement dans les universités régionales renforcent progressivement l’ancrage technologique national et réduisent la dépendance aux importations.
Impact local : infrastructures, jeunesse et développement territorial
Les provinces du Sud connaissent une transformation radicale de leur tissu économique et social. Le port atlantique de Dakhla, dont la première phase de travaux avance à grands pas, créera un hub logistique et énergétique de dimension mondiale, capable de concurrencer les grands ports ouest-africains et de servir de porte d’entrée vers les marchés subsahariens.
La route express Tiznit-Dakhla, axe routier structurant, réduit considérablement les temps de trajet et les coûts de transport, facilitant les échanges commerciaux et l’intégration économique des provinces méridionales au reste du royaume. Cette infrastructure améliore également l’accès aux services publics et ouvre de nouvelles perspectives touristiques.
Les programmes d’énergies renouvelables à Laâyoune et Boujdour transforment ces villes en vitrines technologiques, attirant experts internationaux, investisseurs et délégations étrangères. Cette visibilité internationale renforce l’attractivité des territoires et crée un sentiment de fierté chez les populations locales, qui constatent concrètement la transformation de leur environnement.
Pour la jeunesse saharienne, ces développements ouvrent des horizons professionnels inédits. Plutôt que de migrer vers les grandes métropoles du nord, les jeunes diplômés trouvent désormais localement des opportunités correspondant à leurs qualifications, dans des secteurs d’avenir comme l’ingénierie énergétique, la maintenance industrielle, la gestion de projets ou la logistique portuaire.
Les programmes d’accompagnement incluent des bourses d’études spécialisées, des formations techniques certifiantes et des dispositifs d’insertion professionnelle facilitant le passage de la formation à l’emploi. Cette politique volontariste d’investissement dans le capital humain garantit la pérennité des projets et l’appropriation locale des transformations en cours.
Diplomatie verte : le Maroc comme modèle africain
La convergence entre résolution du dossier du Sahara et leadership climatique confère au Maroc une stature diplomatique unique sur le continent africain. En démontrant qu’il est possible de conjuguer stabilité politique, développement économique et transition énergétique, le royaume offre un modèle inspirant pour d’autres pays africains confrontés à des défis similaires.
Le Maroc accueille régulièrement des délégations africaines désireuses de comprendre les mécanismes de financement, les partenariats public-privé et les modèles de gouvernance qui sous-tendent cette réussite. Cette diplomatie verte renforce l’influence régionale du pays et consolide son rôle de passerelle entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne.
L’organisation de la COP22 à Marrakech en 2016 avait déjà positionné le Maroc comme acteur crédible des négociations climatiques internationales. Les développements actuels dans les provinces du Sud renforcent cette légitimité en démontrant une capacité d’exécution concrète, au-delà des simples engagements diplomatiques.
un modèle d’équilibre entre stabilité, énergie et écologie
Le Maroc trace une voie originale en articulant harmonieusement résolution d’un différend géopolitique historique et construction d’une économie décarbonée compétitive. La reconnaissance internationale croissante de la marocanité du Sahara s’appuie sur des réalisations tangibles qui transforment profondément les provinces du Sud et améliorent concrètement la vie des populations.
La stratégie énergétique déployée dans ces territoires n’est pas un simple vernis écologique mais constitue le cœur d’un projet de développement territorial durable. Avec 370 milliards de dirhams investis dans l’hydrogène vert, des infrastructures portuaires et routières de classe mondiale, et une montée en compétences systématique des ressources humaines locales, le Maroc construit méthodiquement son avenir énergétique et économique.
À l’horizon 2030, les provinces du Sud devraient générer une part significative de la production énergétique nationale, attirer des milliards de dollars d’investissements étrangers et exporter massivement vers l’Europe et l’Asie. Cette vision audacieuse mais pragmatique positionne le royaume comme pont énergétique entre continents et comme pionnier africain de l’économie décarbonée.
Le discours royal attendu pour le 6 novembre 2025 devrait consolider cette trajectoire en traçant les perspectives pour les cinq prochaines années, période cruciale pour concrétiser les ambitions énergétiques nationales et parachever l’intégration économique et sociale des provinces du Sud.
Le Maroc démontre ainsi qu’il est possible de transformer un héritage historique complexe en opportunité de développement durable, offrant un modèle d’équilibre entre stabilité politique, prospérité économique et responsabilité écologique. Un modèle dont l’Afrique et le monde ont besoin en cette décennie décisive pour le climat et la paix.