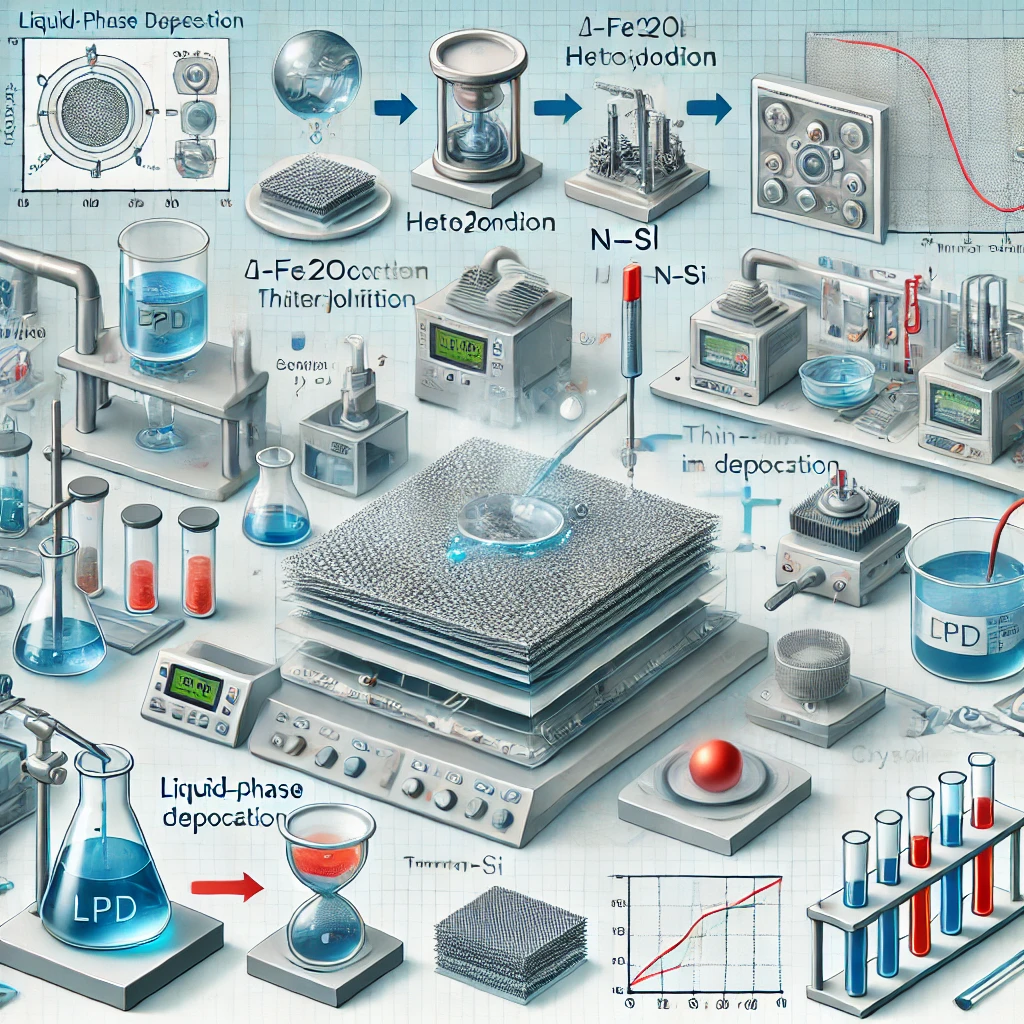L’hiver 2025-2026, un test grandeur nature pour l’Europe énergétique
Alors que l’Europe s’enfonce dans la saison froide, la question de la sécurité énergétique hivernale se pose avec une acuité renouvelée. L’hiver 2025-2026 s’annonce particulièrement scruté : la demande électrique atteint son pic entre décembre et février, le solaire produit peu, et les interconnexions européennes doivent gérer des flux complexes entre pays exportateurs et importateurs. Dans ce contexte tendu, la Suisse dispose d’un atout stratégique majeur : ses barrages alpins et leur capacité unique de stockage saisonnier.
Le 29 octobre 2025, le Conseil fédéral suisse a d’ailleurs prolongé jusqu’en 2030 l’ordonnance sur la réserve d’hiver, témoignant de la vigilance des autorités face aux risques de pénurie. Cette décision pragmatique s’inscrit dans une stratégie plus large où l’hydroélectricité alpine joue le rôle de véritable « batterie saisonnière » pour la Confédération et, par extension, pour l’Europe entière. Mais comment fonctionne concrètement ce système ? Quels sont les défis climatiques et techniques qui se profilent ? Et comment la Suisse se prépare-t-elle à l’horizon 2030 ?
Le rôle central de l’hydroélectricité suisse : un pilier irremplaçable
L’hydroélectricité représente environ 57,6% de la production électrique suisse, faisant du pays l’un des champions européens de cette énergie renouvelable et pilotable. Cette dépendance assumée à la force hydraulique confère à la Suisse une position unique : contrairement à ses voisins encore fortement dépendants du gaz russe ou du charbon, elle dispose d’une ressource locale, décarbonée et flexible.
Les barrages alpins ne sont pas de simples ouvrages de production. Ils constituent de véritables réservoirs énergétiques capables de stocker l’eau durant les périodes d’abondance (fonte printanière et estivale des neiges et glaciers) pour la turbiner durant les mois de forte demande hivernale. Cette fonction de stockage saisonnier fait de l’hydroélectricité alpine un complément indispensable aux énergies renouvelables intermittentes comme le solaire et l’éolien, dont le développement s’accélère en Europe.
La Suisse exporte massivement son électricité en été, lorsque la production hydraulique et solaire dépasse les besoins nationaux. En revanche, elle doit importer durant l’hiver pour combler l’écart entre demande et production. Cette asymétrie saisonnière structure toute la politique énergétique helvétique et justifie les investissements massifs dans le renforcement des capacités de stockage.
Les réserves saisonnières : principe et infrastructures emblématiques
Le concept de réserve saisonnière repose sur un principe simple mais techniquement sophistiqué : accumuler l’eau en altitude durant les mois de fonte (avril à septembre), puis la libérer progressivement durant l’hiver (novembre à mars) pour produire de l’électricité aux moments de pics de consommation. Cette stratégie transforme littéralement les Alpes suisses en une gigantesque batterie naturelle.
Parmi les infrastructures emblématiques, le barrage de la Grande Dixence incarne cette fonction de stockage à l’échelle nationale. Culminant à 285 mètres de hauteur et retenant 400 millions de mètres cubes d’eau, il stocke à lui seul 20% de l’énergie électrique accumulable en Suisse. Le lac des Dix, alimenté par 35 glaciers via 75 prises d’eau et 5 stations de pompage réparties sur 100 kilomètres de galeries souterraines, collecte les eaux d’un bassin versant de 420 km².
Ce système complexe permet de turbiner l’eau sur plusieurs paliers successifs (Fionnay à 1490 m, puis d’autres usines en aval), optimisant ainsi l’exploitation du dénivelé alpin. Le complexe hydroélectrique de Grande Dixence, géré par Alpiq, valorise successivement les eaux des bassins de la Dixence, de la Printze, du Chennaz, de la Borgne et de la Viège, produisant de l’électricité en fonction des besoins des actionnaires et des signaux du marché.
D’autres ouvrages majeurs complètent ce dispositif : le barrage de Mauvoisin en Valais, le lac d’Emosson à la frontière franco-suisse, ou encore le futur barrage du Gornerli, projet phare de la Table ronde sur l’hydroélectricité. Ce dernier, intégré au réseau de la Grande Dixence, devrait apporter jusqu’à un tiers des 2 TWh supplémentaires visés par l’ensemble des projets nationaux de renforcement hivernal, constituant ainsi « le projet majeur de l’approvisionnement énergétique du pays ».
Gestion et innovation : piloter la ressource avec précision
La gestion de ces réserves saisonnières mobilise des technologies de pointe. Les centres d’exploitation d’Alpiq et de Grande Dixence reçoivent en temps réel les données de milliers de points de mesure : débits d’affluence, niveaux de remplissage, prévisions météorologiques et hydrologiques, prix de marché, demande prévisionnelle. Cette télémesure permanente permet d’optimiser minute par minute la production en fonction des besoins et des opportunités économiques.
La digitalisation transforme progressivement cette gestion. Des modèles prédictifs intégrant intelligence artificielle et données climatiques affinent les scénarios de remplissage et de turbinage. L’entretien préventif bénéficie de capteurs intelligents détectant les anomalies avant qu’elles ne deviennent critiques. La maintenance s’organise durant les périodes de faible demande pour maximiser la disponibilité hivernale des installations.
L’arbitrage entre stockage et turbinage constitue un exercice délicat. Retenir l’eau trop longtemps fait perdre des opportunités de vente quand les prix sont élevés. La turbiner trop tôt expose au risque de manquer d’eau en fin d’hiver, période critique où les importations européennes sont les plus coûteuses et les plus incertaines. Les exploitants naviguent donc constamment entre optimisation économique et sécurité d’approvisionnement.
La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) définit chaque année les paramètres de la réserve hydroélectrique obligatoire : volume minimal à conserver, période de restriction, modalités d’activation. Pour l’hiver 2024-2025, cette réserve vise à garantir la capacité d’approvisionnement pendant quelques semaines critiques en fin d’hiver, en cas de consommation indigène accrue, de disponibilité réduite des centrales suisses et de possibilités d’importation restreintes.
Enjeux climatiques : quand les glaciers disparaissent
Le changement climatique bouleverse profondément les conditions d’exploitation des barrages alpins. Une étude récente de l’EPFL portant sur le barrage de Gries, situé à 2387 mètres en Valais, pose une question provocatrice mais lucide : « Qui disparaîtra en premier, le glacier ou le réservoir ? » La réponse ne fait malheureusement pas mystère : le glacier de Gries devrait disparaître vers 2070, bien avant l’obsolescence de l’infrastructure.
À partir de cette décennie critique, l’apport en eau se limitera aux précipitations pluvieuses et neigeuses et à la fonte des neiges, soit 30% de moins qu’aujourd’hui d’ici 2100. Le réservoir devra alors assumer partiellement le rôle régulateur jusqu’alors rempli par le glacier, stockant l’eau du printemps et de l’été pour la libérer durant les mois secs et froids.
Cette transformation impose une refonte complète de la gestion hydrologique. Les précipitations deviennent plus irrégulières, avec des épisodes de pluies intenses alternant avec des périodes de sécheresse. La limite pluie-neige remonte en altitude, réduisant le manteau neival qui constituait une réserve naturelle s’écoulant progressivement au printemps. Les débits d’affluence deviennent plus volatils, compliquant les prévisions de remplissage.
Les barrages doivent donc devenir multifonctionnels, assumant simultanément production électrique, régulation hydrologique, protection contre les crues et préservation de la ressource en eau pour d’autres usages (irrigation, eau potable, tourisme). Cette multifonctionnalité accrue nécessite des arbitrages complexes entre acteurs aux intérêts parfois divergents, d’où l’urgence d’agir « tant au niveau technique que politique » pour prévenir d’éventuels conflits futurs.
Coopération européenne : les Alpes, batterie du continent
Le réseau électrique suisse ne fonctionne pas en vase clos. Il est totalement interconnecté avec ses voisins français, allemand, italien et autrichien, formant un système européen où les flux d’électricité circulent en permanence pour équilibrer offre et demande. Dans ce contexte continental, les Alpes suisses jouent un rôle de batterie et de régulateur pour l’ensemble de l’Europe.
Cette fonction de flexibilité est d’autant plus précieuse que les énergies renouvelables intermittentes (solaire et éolien) se développent massivement en Europe du Nord et du Sud. Lorsque le vent souffle fort sur la mer du Nord ou que le soleil brille sur l’Italie, la Suisse peut pomper l’eau vers ses réservoirs d’altitude, stockant ainsi l’électricité excédentaire sous forme d’énergie potentielle. Inversement, lors des pics de demande hivernale ou des périodes sans vent ni soleil, elle turbine cette eau pour injecter rapidement des mégawatts sur le réseau européen.
Les installations de pompage-turbinage constituent l’outil technologique privilégié de cette régulation. Des projets comme le Gornerli intégreront cette double fonction, renforçant la capacité de la Suisse à absorber les surplus renouvelables européens en été et à les restituer en hiver, tout en générant des revenus substantiels via l’arbitrage des prix horaires.
Cette interdépendance européenne impose toutefois une coordination étroite entre gestionnaires de réseaux. Swissgrid, l’opérateur suisse du réseau de transport, dialogue en permanence avec ses homologues pour anticiper les situations tendues, planifier les maintenances et garantir la stabilité collective. Les réserves suisses contribuent ainsi à la sécurité énergétique de tout le continent, positionnant la Confédération comme acteur pivot de la transition européenne.
Perspectives 2025-2030 : moderniser pour sécuriser l’avenir
L’horizon 2030 structure la feuille de route énergétique helvétique. La prolongation de l’ordonnance sur la réserve d’hiver jusqu’en 2030 offre la visibilité nécessaire pour planifier les investissements de modernisation et de renforcement des capacités. Cinq nouvelles centrales de réserve thermique entreront en service à partir de 2030, complétant le dispositif hydraulique par des moyens flexibles de dernier recours.
Parallèlement, les projets de la Table ronde sur l’hydroélectricité visent à augmenter de 2 TWh la production hivernale d’ici 2035, soit environ 10% de la consommation annuelle suisse. Le Gornerli constitue la pierre angulaire de cette stratégie, apportant à lui seul un tiers de cet objectif grâce à sa capacité de stockage saisonnier massive.
L’intégration du solaire alpin représente une autre piste prometteuse. Les panneaux photovoltaïques installés en altitude bénéficient d’un ensoleillement exceptionnel, de l’effet albédo de la neige et d’un meilleur rendement grâce aux températures fraîches. Cette production hivernale complémente idéalement l’hydraulique, réduisant la dépendance aux importations durant les mois critiques.
L’équilibre entre développement énergétique et préservation écologique constitue un défi permanent. Chaque nouveau projet doit démontrer sa compatibilité avec les exigences environnementales : préservation des débits résiduels, protection de l’ichtyofaune, limitation de l’impact paysager, concertation avec les communautés locales. Cette exigence de durabilité intégrale ralentit certes les réalisations, mais garantit l’acceptabilité sociale et la pérennité des infrastructures.
Les Alpes, citadelle énergétique d’une Europe décarbonée
Les barrages alpins suisses incarnent une vision où géographie, technologie et stratégie convergent pour sécuriser l’approvisionnement électrique hivernal. En stockant l’eau de fonte estivale pour la turbiner durant les mois de forte demande, ces infrastructures centenaires se réinventent comme batteries saisonnières indispensables à la transition énergétique européenne.
Face aux défis climatiques qui menacent les apports glaciaires, la Suisse anticipe, modernise et diversifie. L’intégration du pompage-turbinage, le développement du solaire alpin, la digitalisation de la gestion et la coordination européenne renforcée dessinent un système énergétique résilient, flexible et décarboné.
À l’horizon 2030, les Alpes suisses devraient confirmer leur statut de citadelle énergétique du continent, démontrant qu’une gestion intelligente des ressources naturelles, couplée à l’innovation technologique et à la coopération transfrontalière, peut concilier sécurité d’approvisionnement, compétitivité économique et responsabilité écologique. Un modèle dont l’Europe, engagée dans sa transition vers la neutralité carbone, aura plus que jamais besoin durant les hivers à venir.